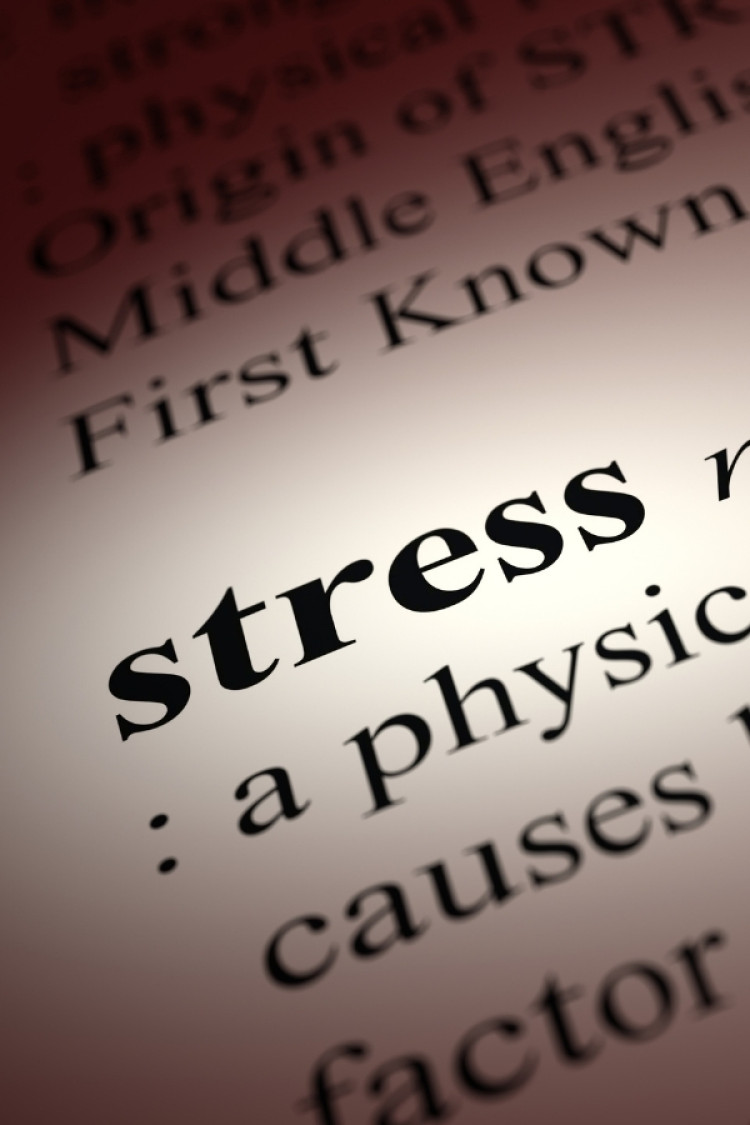La fatigue ou le manque d’énergie sont des plaintes fréquentes en pratique et ont souvent des causes multifactorielles. Le stress chronique constitue l’un des facteurs perturbateurs les plus sous-estimés. Cet article décrit la physiologie du stress, le rôle de l’axe HHS (hypothalamo-hypophyso-surrénalien), les effets de son activation chronique et les pistes de rétablissement dans un cadre complémentaire.
Table des matières
- Qu’est-ce que le stress exactement ?
- Eustress et détresse : quand le stress bascule
- Capacité et charge : l’équilibre personnel face au stress
- Stress aigu versus stress chronique
- Les deux voies du stress : système sympathique et axe HHS
- Conséquences physiologiques du stress chronique
- Reconnaître les signaux du stress
- Pistes thérapeutiques
- Conclusion
Eustress et détresse : quand le stress bascule
Un certain degré de tension est fonctionnel. L’eustress, forme positive du stress, favorise la vigilance, la motivation et la croissance. Il s’agit, par exemple, de la tension ressentie avant une présentation ou une compétition sportive. Ce stress est temporaire et disparaît dès que la stimulation cesse.
Lorsque les stresseurs persistent ou dépassent la capacité d’adaptation individuelle, on parle de détresse. Le système physiologique reste alors chroniquement activé, conduisant à une surcharge allostatique — le point où l’adaptation se transforme en dysrégulation.
Capacité et charge : l’équilibre personnel face au stress
La réponse individuelle au stress dépend de facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux précoces. Les expériences vécues dans l’enfance influencent la réactivité de l’axe HHS : certaines personnes développent une tolérance élevée au stress et s’ajustent rapidement (les habituateurs), tandis que d’autres conservent une sensibilité accrue (les non-habituateurs).
Les traits de personnalité, les styles d’adaptation, la qualité du sommeil et le statut en micronutriments contribuent tous à cette capacité d’adaptation. Lorsque la charge, externe ou interne, dépasse durablement cette capacité, un déséquilibre apparaît.
Les deux voies du stress : système sympathique et axe HHS
Le corps réagit au stress via deux voies distinctes :
- La voie rapide – le système nerveux sympathique (axe SAM)
Cette voie déclenche la réaction de stress aiguë. En quelques secondes, l’hypothalamus stimule la médullosurrénale pour libérer adrénaline et noradrénaline, augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la disponibilité du glucose.
Le parasympathique prend ensuite le relais pour restaurer l’équilibre. - La voie lente – l’axe HHS
Si le stress persiste plus de 30 minutes, l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien s’active. L’hypothalamus libère la CRH (corticotropin-releasing hormone), stimulant l’hypophyse à sécréter l’ACTH, qui à son tour incite les glandes surrénales à produire du cortisol.
Ce dernier mobilise le glucose, régule le métabolisme des graisses et des protéines, et module les processus immunitaires et inflammatoires.
Normalement, un mécanisme de rétroaction négative réduit la production d’ACTH, mais sous stress chronique, cette régulation se dérègle, entraînant des taux de cortisol anormaux.
Reconnaître les signaux du stress
Pour les professionnels, il est essentiel d’identifier précocement les signes subtils : troubles du sommeil, fatigue matinale persistante, irritabilité, troubles digestifs, infections récurrentes, déséquilibres hormonaux ou douleurs diffuses. Sur le plan biologique : altérations du rythme du cortisol, diminution de la DHEA, élévation de l’ACTH ou de la prolactine, perturbations du profil lipidique et glucidique (glycémie), inflammation (CRP, interleukines), baisse du BDNF, stress oxydatif accru ou réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).
Pistes thérapeutiques
La gestion du stress chronique vise à restaurer l’équilibre neuro-endocrinien, énergétique et cellulaire. Axes d’intervention :
- Normalisation de l’axe HHS : soutien des mécanismes de rétroaction via des adaptogènes et des micronutriments tels que le zinc, le magnésium et les vitamines B. Des produits comme Methialyn, Zinargin et Curmac peuvent être envisagés en complément.
- Soutien mitochondrial : nutriments qui limitent le stress oxydatif et optimisent la production d’ATP.
- Synthèse des neurotransmetteurs : soutien du métabolisme de la sérotonine et de la dopamine grâce à un apport adéquat en protéines, vitamine B6, folate et magnésium.
- Restauration du rythme de vie : rythme veille-sommeil régulier, exposition à la lumière naturelle, activité physique et relaxation.
- Accompagnement et conscience : coaching ou suivi psychologique axé sur la gestion du stress et l’autorégulation, en complément d’une approche nutritionnelle.
Sur la base du profil de plainte et de l’anamnèse, il est possible de déterminer si la dysrégulation prédomine au niveau central (axe HHS), périphérique (mitochondrial) ou systémique (inflammatoire), et d’orienter le plan thérapeutique en conséquence.
Conclusion
Le stress fait partie de la vie, mais l’activation chronique de l’axe HHS ne devrait pas en être une conséquence inévitable. Pour les professionnels de santé, le défi consiste à reconnaître la transition subtile entre adaptation et dérèglement, et à offrir un accompagnement intégratif favorisant la récupération physiologique et psychologique.
Référence
- McEwen B.S. (2017). Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. Chronic Stress (Thousand Oaks)
- Noushad S. et al. (2021). Physiological biomarkers of chronic stress: A systematic review. Int J Health Sci (Qassim), 15(5):46-59
- Alotiby A. (2024). Immunology of Stress: A Review Article. J Clin Med, 13(21):6394